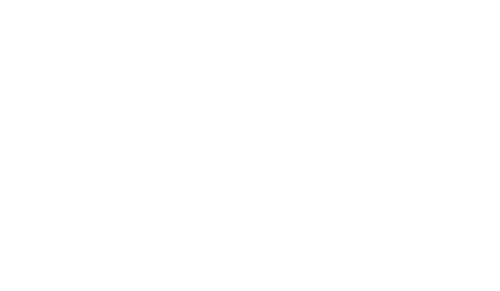La fipec décrypte
Nos réponses à vos questions
Mise à jour de mars 2025
Décoder les peintures, vernis, colles, encres d’imprimerie, couleurs pour artistes et résines : votre guide pratique
Découvrez les réponses à vos questions sur nos produits. De la signification des pictogrammes aux informations sur les composants et l’impact environnemental, nous vous aidons à faire des choix éclairés pour vos projets tout en respectant votre santé et l’environnement.
SOMMAIRE
Les allégations environnementales
Biosourcé
Dépolluant
Eco-conception
Empreinte écologique réduite
Naturel
RéEMPLOI/RéUTILISATION
RECYCLABLE
Les définitions techniques liées à la composition des produits
LES GRANULÉS DE PLASTIQUES INDUSTRIELS
MICROPLASTIQUES ET MICROPARTICULES DE POLYMÈRE SYNTHÉTIQUE
Les notions clés d’une fédération professionnelle

Biosourcé
Définition :
Se dit d’un produit, d’une matière ou d’un matériau entièrement ou partiellement fabriqué à partir de biomasse (végétale ou animale), à l’exclusion des matières fossilisées comme le pétrole ou le charbon qu’il remplace notamment.
La teneur biosourcée d’un produit ne fournit pas d’informations sur l’impact environnemental ou la durabilité de ce dernier, lesquels peuvent être évalués par une analyse du cycle de vie (ACV) et selon des critères de durabilité.
Applications :
Sa mention doit être accompagnée d’une explication concernant le caractère biosourcé du produit, à savoir (Norme NF EN 16640 (teneur en carbone biosourcé analyse au radiocarbone) :
- Des précisions lisibles et visibles sur la teneur en matière/carbone biosourcé(e) du produit et/ou son emballage.
- Des précisions sur ce qui est biosourcé : le produit, l’emballage ou un composant.
- Des précisions sur la ou les biomasse(s) et/ou la ou les matière(s) biosourcée(s) employée(s) dans le produit.
- La nature et si possible l’ampleur des réductions d’impacts environnementaux résultant de la démarche biosourcée.
Source : Guide CNC des allégations environnementales 2023 et Référentiel des peintures et vernis biosourcés du Sipev
Référentiel Sipev : Consulter le PDF
Réalisation d’ACV comparatives de produits biosourcés au format FDES : Consulter le PDF
Plaquette ACDV / Fipec : Consulter le PDF

Dépolluant
Définition : Dépolluant, assainissant, purifiant
Les allégations comprenant les termes « dépolluant, assainissant, purifiant » sont généralement utilisées pour des produits, matériaux ou plantes dont l’utilisation revendique un effet d’amélioration de la qualité de l’air intérieur.
L’allégation est utilisée pour qualifier des produits, matériaux et plantes revendiquant une diminution dans l’air du niveau d’un ou plusieurs polluants (sous forme de gaz, particule, ou biologique).
L’allégation est à utiliser si des tests et méthodes scientifiquement robustes ont pu démontrer des résultats significatifs pour des conditions d’applications bien précises, et ce, en l’absence de tests ou méthodes normalisés ou reconnus réglementairement.
L’allégation ne devrait être utilisée que si la démonstration de l’effet d’amélioration de la qualité de l’air est faite dans des conditions d’usage réel.
Peintures et autres matériaux de construction :
L’allégation « dépolluant » est notamment utilisée pour certaines peintures décoratives. Ces peintures mettent en avant la neutralisation ou destruction de certaines substances qui constituent des polluants de l’air intérieur, en s’appuyant notamment sur des tests et méthodes fondés sur les normes ISO de la série 16000.
Applications :
Sa mention doit être accompagnée de précisions :
- La substance ou la famille de substances polluantes de l’air intérieur sur laquelle le procédé utilisé agit efficacement
- Le test utilisé pour objectiver l’action dépolluante revendiquée
- Un accès à l’information détaillée du respect de la norme ou d’autres tests démontrant la réduction de la pollution sur un support décalé (web ou autre)
ATTENTION : Les termes «assainissant» et «purifiant» sont ambigus parce qu’ils peuvent renvoyer à une action biocide pour laquelle il existe une réglementation spécifique. Le professionnel doit préciser l’effet lié à l’utilisation du produit.
Source : Guide CNC des allégations environnementales 2023
Eco-conception
Définition :
Intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit afin d’améliorer sa performance environnementale tout au long du cycle de vie. Sont pris en compte les impacts et aspects environnementaux significatifs sur l’ensemble du cycle de vie.
Applications :
L’entreprise doit pouvoir fournir des éléments pertinents, mesurables, vérifiables et concrets démontrant sa démarche d’écoconception relative au produit.
Exemple : une étude de mise en œuvre d’actions d’amélioration du produit sur les effets significatifs du produit (ex, l’intégration de matières biosourcées, la substitution d’un solvant par de l’eau), ou la certification par un label environnemental (ex, Ecolabel européen, NF environnement…)
Recommandations :
Indiquer la définition de l’écoconception donnée par la directive 2009/125.
Préciser ce qui est écoconçu par la mention « produit éco-conçu » ou « emballage éco-conçu ».
À défaut, le terme éco-conçu vise le produit et son emballage.
2 conditions cumulatives :
- Indiquer les principales caractéristiques environnementales du produit et/ou de son emballage.
- Indiquer la nature et l’ampleur des réductions significatives des effets sur l’environnement et sur l’ensemble du cycle de vie du produit résultant de la démarche d’écoconception.
Pour en savoir plus…
Le règlement (UE) 2024/1781 dit « Ecoconception » publié au Journal officiel de l’Union européenne du 28 juin 2024 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401781
Empreinte écologique réduite
Définition :
Réduction significative de l’effet sur l’environnement du produit tout au long de son cycle de vie en comparaison avec des produits conventionnels de la même catégorie.
> Assimilable aux allégations « moins polluant » ou « réduction de l’impact environnemental ».
Applications :
Pour mettre en avant l’empreinte écologique réduite d’un produit, il est donc nécessaire de démontrer une réduction significative des effets sur l’environnementdu produit tout au long de son cycle de vie. En ce sens, il existe des démarches privées et volontaires d’entreprises, pouvant faire l’objet d’un contrôle par un organisme indépendant, comme l’Ecolabel européen.
Le calcul, impose l’identification des effets les plus significatifs du produit pour l’ensemble de son cycle de vie.
Par exemple, les émissions de COV induites par l’application d’une peinture, ou les éventuels résidus de détergent dans l’eau.
Recommandations :
- Préciser ce qui est qualifié par l’allégation : l’emballage et/ou tout ou partie du produit. A défaut, l’allégation s’applique au produit et son emballage.
- Indiquer en quoi le produit et/ou son emballage a une réduction significative de l’effet sur l’environnement, complété éventuellement par tout autre moyen approprié.
Exemple : une moindre teneur en solvants, consommation d’énergie réduite, émissions de CO2 diminuées. - Indiquer la nature et l’ampleur des réductions des effets sur l’environnement sur la base d’une méthode de calcul de type ACV (analyse de cycle de vie) à l’échelle du produit et/ou de l’emballage concerné, et non d’une partie du produit.
- Attention, les produits soumis à des obligations d’éco-conception ne peuvent cumuler l’allégation « empreinte écologique réduite » que si le produit répond à des critères supérieurs-aux exigences réglementaires.)
Les granulés de plastiques industriels
Définition :
Les granulés de plastiques industriels sont des matières premières plastiques (billes, copeaux, etc.) dont les dimensions sont comprises entre 0,01 mm et 1 cm (article D541-360 du Code de l’environnement).
Ils ne relèvent pas directement de la définition de microplastiques au sens du règlement REACh, mais leur dispersion accidentelle dans l’environnement constitue une source bien identifiée de pollution plastique.
Applications
Depuis la publication du décret d’application de la loi AGEC, toute entreprise produisant, manipulant ou transportant ces granulés doit mettre en œuvre des mesures strictes :
- identification des zones à risque sur le site,
- contrôle de l’étanchéité des emballages,
- ramassage immédiat de tout granulé accidentellement dispersé,
- nettoyage régulier des bassins de rétention, caniveaux, sols,
- vérification du bon état des équipements de confinement,
- formation du personnel et affichage des consignes,
- réalisation de contrôles internes semestriels.
Recommandations
Les contenants transportant des granulés plastiques doivent être clairement identifiés, afin de limiter les risques de dispersion et de confusion logistique.
Notre secteur adhère pleinement à ces exigences. La lutte contre la pollution plastique commence par une gestion rigoureuse en amont, à travers des gestes professionnels fiables et une vigilance partagée. C’est aussi une condition essentielle pour renforcer la confiance avec les parties prenantes.
Microplastiques et microparticules de polymère synthétique
Définition :
À ce jour, il n’existe aucune définition universellement reconnue des microplastiques. Le terme désigne communément de petites particules solides de matières plastiques, généralement inférieures à 5 mm (source : ECHA – European Chemicals Agency). Toutefois, les critères peuvent varier selon les sources (scientifiques, institutionnelles ou réglementaires), ce qui rend le sujet à la fois complexe et sensible.
Pour clarifier cette notion, l’Union européenne a introduit une définition juridiquement contraignante dans le cadre du point 78 de l’annexe XVII du règlement REACh, entrée en vigueur en 2023 : celle de microparticules de polymère synthétique (MPPS). Il s’agit de polymères solides, présents dans un produit à hauteur d’au moins 1 % en masse des particules, sous forme de :
- particules dont toutes les dimensions sont ≤ 5 mm,
- fibres dont la longueur est ≤ 15 mm avec un diamètre > 3 mm.
Sont exclues de cette définition :
- les substances non chimiquement modifiées,
- les polymères biodégradables ou solubles à plus de 2 g/l,
- les substances ne contenant pas d’atomes de carbone.
Dans ce cadre, on distingue :
- les microplastiques primaires, ajoutés intentionnellement pour leurs propriétés fonctionnelles,
- les microplastiques secondaires, issus de l’usure ou de la dégradation progressive des plastiques au fil du temps (par exemple la dégradation d’une bouteille laissée dans l’environnement).
Toutes les microparticules de polymère synthétique sont des microplastiques, mais tous les microplastiques ne sont pas des MPPS au sens du règlement REACh.
Certaines matières premières qui rentrent dans la formulation de nos produits (peintures, encres, colles, etc.) peuvent relever de cette définition.
Une fois secs, les revêtements sont filmogènes, ce qui rend la libération de particules microplastiques peu probable.
Des efforts sont tout particulièrement portés sur l’innovation, permettant ainsi à nos produits d’être plus performants et plus durables, des produits toujours plus efficaces et qui renforcent ainsi notre ambition de limiter les rejets.
Applications
Depuis l’entrée en vigueur de l’article 78 du règlement REACh, les produits contenant des microparticules de polymère synthétique (MPPS) sont soumis à des restrictions strictes.
Tout produit (substance ou mélange) contenant ≥ 0,01 % en masse de MPPS ne peut pas être mis sur le marché, sauf dans les cas suivants :
- les particules sont confinées par des moyens techniques évitant tout rejet dans l’environnement,
- leurs propriétés physiques sont modifiées de manière permanente, les rendant non assimilables à des microplastiques,
- elles sont incorporées de façon irréversible dans une matrice solide (ex. : film de peinture durci),
- le produit est réservé à un usage industriel sur site contrôlé.
Si la concentration ne peut être précisément déterminée, seules sont prises en compte :
- les particules ≥ 0,1 μm, pour les formes ≤ 5 mm,
- ou les fibres ≥ 0,3 μm de long, si elles mesurent ≤ 15 mm avec un rapport longueur/diamètre > 3.
À compter du 17 octobre 2025, les fournisseurs de matières premières entrant dans la composition de nos produits devront aussi :
- inclure des instructions claires pour éviter les rejets,
- apposer la mention réglementaire REACh (article 78),
- indiquer la quantité ou concentration de MPPS dans le produit,
- fournir des informations génériques sur l’identité des polymères.
Les fabricants, importateurs et utilisateurs industriels devront également, à la demande des autorités :
- fournir des informations sur l’identité et la fonction des polymères concernés,
- et pour les substances exclues (dégradables ou solubles), prouver leur caractère.
La Fipec accompagne activement la mise en œuvre de ces règles, avec une attention particulière à éviter les effets contre-productifs, comme le remplacement de polymères sûrs par des alternatives moins performantes ou plus dommageables.
Recommandations
En cohérence avec la position du CEPE (Conseil européen de l’industrie des peintures, encres et couleurs), notre fédération appelle à un traitement proportionné, fondé sur la science, et orienté vers des solutions concrètes.
Nous soulignons que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de conclure de manière fiable que les produits de notre secteur seraient une source significative de pollution microplastique. C’est pourquoi le CEPE a engagé des études indépendantes (en cours) sur :
- la libération potentielle de microparticules issues des films de peinture en façade,
- l’impact réel des peintures antifouling en environnement marin.
Parallèlement, notre filière agit :
- en améliorant la durabilité et les performances des produits (ce qui réduit la fréquence d’entretien),
- en promouvant les bonnes pratiques d’application, de nettoyage et de gestion des déchets (résidus, eaux de rinçage, poussières),
- en accompagnant ses adhérents dans la mise en conformité (étiquetage, traçabilité, documentation, etc.),
- en dialoguant avec les autorités françaises et européennes pour garantir que les réglementations restent scientifiquement fondées, sans nuire à l’innovation ni à la performance environnementale.
Sources : https://cepe.org/microplastics/
Produits en plastique interdits
Service-Public.fr
https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20181116STO19217/microplastiques-sources-impact-et-solutions
Naturel
Définition :
Le mot naturel concerne un produit peu transformé, proche de son état d’origine.
Le produit doit contenir au moins 95 % de composants naturels.
La définition de REACh :
« Substances présentes dans la « nature » : une substance naturelle, telle quelle, non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau ou qui est extraite de l’air par un quelconque moyen ».
Si le produit est qualifié de « naturel » (par exemple : peinture « naturelle »), il doit contenir au moins 95 % de composants naturels. En dessous de ce seuil seuls les composants peuvent être qualifiés de « naturels » (par exemple : « peinture à base d’huile végétale naturelle »).
Recommandations :
- Indiquer systématiquement le pourcentage et la nature des composants naturels.
- Quel que soit le ratio, préciser la composition du produit et les composants dits « naturels », selon la doctrine élaborée par la DGCCRF.
- L’entreprise doit pouvoir justifier de la nature et du pourcentage des substances naturelles composant le produit.
- Préciser que naturel ne signifie ni « absence de danger » pour la santé humaine ou les écosystèmes, ni réduction des impacts environnementaux.
- Des démarches privées et volontaires prévoyant l’incorporation d’ingrédients naturels dans le produit existent. Elles peuvent faire l’objet d’un contrôle par un organisme indépendant.
Source : Guide CNC des allégations environnementales 2023
Représentativité patronale
Définition
La représentativité patronale, fixée par la loi (article L 2152-1 du Code du travail), désigne l’aptitude d’une organisation patronale à représenter des employeurs dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts au sein d’une branche souvent plus large (par exemple, la Fipec au sein de l’industrie chimique réunie au sein de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 0044)).
Elle ne doit pas être confondue avec la représentation d’un secteur d’activité par un syndicat ou une Fédération patronale comme la Fipec qui, avec près de 150 entreprises adhérentes et 20 000 salariés, représente 95 % des entreprises de la filière.
Elle confère aux organisations patronales le pouvoir d’exercer un certain nombre de prérogatives telles que le droit de négocier et conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales qui déterminent le droit applicable aux salariés de leurs entreprises adhérentes et, après extension, à l’ensemble des entreprises de la branche professionnelle.
La représentativité patronale donne légitimité et crédibilité à une organisation patronale pour défendre les intérêts des entreprises de son secteur d’activité au sein des instances paritaires et auprès des pouvoirs publics.
La dernière mesure de représentativité date de 2025 (Arrêté du 23 octobre 2025 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC n° 0044) – Légifrance) les entreprises du secteur de la chimie sont réparties comme suit :
France chimie : 58,4 %, Febea : 11.45 %, Cosmed: 20.89 % et Fipec : 9.26 %.
Réemploi/Réutilisation
Définition
Le réemploi désigne toute opération par laquelle des matières, ou produits qui ne sont pas des déchets, sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
La réutilisation désigne toute opération par laquelle des matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau. Lorsqu’on parle de préparation en vue de la réutilisation, on évoque toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement.
Selon qu’on emploie « réemploi » ou « réutilisation », on pourra déduire que le bien en fin de vie est un déchet (réutilisation), ou non (réemploi).
Les deux visent à prolonger la durée de vie des produits et à réduire la production de déchets.
Applications
Pour les produits généraux, il est possible de mettre en avant son réemploi ou sa réutilisation, par exemple, pour appuyer sur la capacité d’allonger la durée de vie du produit, de manière effective, significative et sans altération au fil de son usage.
Sur les emballages ménagers, le fabricant ou l’importateur a l’obligation d’informer le consommateur sur les possibilités de réemploi du produit soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP), suivant une fiche produit accessible en ligne.
Un emballage ménager est considéré comme réemployable uniquement s’il est conçu pour être utilisé une seconde fois, soit :
– pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou réutilisation est organisé par, ou pour, le compte du producteur ;
– ou en étant rempli au point de vente, dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur est réputé être réemployé.
Les mentions obligatoires : « emballage réemployable » ou « emballage rechargeable ».
Les mentions volontaires : informations complémentaires sur le produit ou sa fiche produit, sous réserve que cela n’entraîne pas de confusion pour le consommateur.
Recommandations
Il est recommandé d’utiliser les termes adaptés : « réemployable » ou « réutilisabl »e.
Attention : « réemploi » et « réutilisation » sont différents de « reconditionnement ». En l’occurrence, aucun produit fabriqué par les adhérents de la Fipec ne sont actuellement sujet au reconditionnement
Doivent être indiquées les conditions d’utilisation du produit pour le consommateur, afin que le produit soit effectivement réemployable, ou réutilisable.
Doit être indiqué le nombre d’utilisations conseillé du produit.
Recyclable
Définition
Le terme caractérise un produit, un emballage ou un composant associé, qui peut être extrait des déchets par des processus et des programmes disponibles, et qui peut être collecté, traité et remis en usage sous la forme de matières premières ou de produits.
Applications
Produits et emballages relevant du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 : Obligation pour le fabricant ou l’importateur d’informer le consommateur sur le caractère recyclable du produit soumis à la responsabilité élargie du producteur (REP) suivant une fiche produit accessible en ligne.
Sont concernés les emballages ménagers, imprimés papiers, produits et matériaux de construction du bâtiment, contenus et contenants de produits chimiques, ainsi que des éléments d’ameublement.
Pour apposer une mention « recyclable », cinq critères cumulatifs doivent être remplis, dont un qui est variable et qui impacte la mention appropriée. (art R541-221 CED)
4 constants :
– une capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité.
– une capacité à être trié, soit orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé.
– une absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée.
– une capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue peut être utilisée de manière durable dans la fabrication de nouveaux produits, et que la filière de recyclage dispose d’une capacité suffisante pour prendre en charge les produits.
1 variable :
– une capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté.
-> Mention = « produit majoritairement recyclable » ou « emballage majoritairement recyclable »
– une capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté.
-> Mention = « produit entièrement recyclable » ou « emballage majoritairement recyclable »
– une capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière
-> Mention = « produit recyclable en un produit de même nature » ou « emballage recyclable en un emballage de même nature »
Produits ne relevant pas du décret n° 2022-748 : Possible de mettre en avant recyclabilité des produits, notamment en s’appuyant sur le respect des cinq critères cumulatifs énoncés ci-dessus.
Recommandations
Indiquer ce qui est précisément recyclable
Indiquer les conditions de la recyclabilité alléguée (collecte ou apport spécifique du déchet, taux de recyclage moyen pratiqué par la filière)
Utiliser le sigle Triman, accompagné de l’Info-tri, qui indique que le produit à destination des consommateurs, une fois usagé, fait l’objet d’une collecte spécifique et que la gestion de ces déchets est financée par les producteurs.
(-> insérer image info tri ci desssous)
Cas particulier des contenus et contenants des produits chimiques (DDS) ; il n’existe pas encore de sigles officiels dans ce secteur.